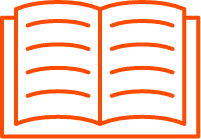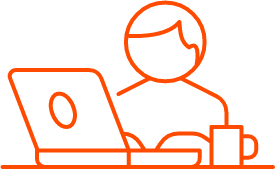Écouter du Mozart pour augmenter son intelligence ? L’âge de 3 ans marque une période critique après laquelle les enfants rencontrent des défis pour assimiler de nouvelles connaissances ? Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau ? Toutes ces notions couramment répandues sur le développement cérébral sont en réalité erronées. Elles sont des neuromythes, des croyances sans fondement concernant le cerveau. De nos jours, les experts en éducation voient dans les neurosciences une opportunité pour progresser vers un apprentissage plus équitable et efficace.
Porté par un succès médiatique réel et un intérêt grandissant du public, le concept de « neuro-éducation » a vu le jour. Les enseignants sont les professionnels de la plasticité cérébrale de leurs élèves pendant leur apprentissage. Ils ne peuvent tolérer la persistance de rumeurs fausses et préjudiciables. Il est également de leur devoir en tant que pédagogues et scientifiques de fournir des connaissances fiables. Explorez les neuromythes les plus connus ainsi que des explications fondées pour chacun d’entre eux.
Neuromythe n°1 : Nous n’utilisons que 10 % de notre cerveau
Ceci est le neuromythe le plus répandu, bien que l’origine de cette idée reste inconnue à ce jour. Certains l’attribuent à un neurochirurgien italien du 19e siècle, qui prélevait des parties du cerveau de ses patients pour mieux comprendre leurs maladies. D’autres l’associent à Albert Einstein, qui aurait plaisanté avec un journaliste en prétendant qu’il n’utilisait que 10 % de son cerveau. Le cinéma a également renforcé cette croyance avec le film « Lucy » de Luc Besson.
Pourquoi est-ce une fausse croyance ? De nombreux experts, notamment le neurologue Barry Beyerstein, ont démontré que toutes les zones cérébrales sont exploitées par l’homme. Les techniques d’imagerie médicale et cérébrale confirment que le cerveau est en activité constante, même pendant le sommeil. Cependant, il convient de noter qu’une surstimulation du cerveau peut entraîner une saturation de la mémoire de travail.
Neuromythe n°2 : Tout se joue avant l’âge de 3 ans
Bien que cette idée soit l’un des neuromythes les plus populaires, elle n’est pas tout à fait fausse. Selon cette croyance, les connexions neuronales se développent de manière intensive au cours des trois premières années de la vie, puis ce rythme ralentit au fil des ans.
Au début du XXe siècle, Maria Montessori a observé qu’au cours de ces trois premières années, les enfants connaissent un pic de réceptivité et d’enthousiasme pour l’apprentissage. Par la suite, les neurosciences ont confirmé qu’une croissance synaptique significative a lieu au cours de ces années, favorisant l’apprentissage.
Pourquoi est-ce une fausse croyance ? Il ne faut pas croire que « tout est joué » avant l’âge de 3 ans et que l’apprentissage de nouvelles choses est impossible par la suite. Même si le développement des connexions neuronales ralentit, il ne s’arrête pas. Des recherches menées à Stanford ont montré que certaines zones du cerveau continuent de produire des neurones même à l’âge adulte, contrairement à ce que l’on pensait il y a plus de 10 ans. L’homme est programmé neurologiquement pour apprendre tout au long de sa vie, même à un âge avancé.
De plus, la spécialiste Catherine L’Ecuyer explique que pendant les trois premières années de l’enfant, ce qui importe le plus est la relation affective.
« Plus les besoins fondamentaux de l’enfant sont satisfaits, plus sa confiance en lui grandit, et plus le lien d’attachement est sécurisant. C’est une période « sensible » pour l’attachement, mais pas une période critique pour l’apprentissage. »
Il vaut donc mieux privilégier la relation avec son enfant plutôt que de le submerger d’informations.
Neuromythe n°3 : Le « cerveau gauche » et le « cerveau droit »
Selon ce neuromythe, le « cerveau droit » serait le siège des émotions, de l’imagination et de la créativité, tandis que le « cerveau gauche » serait dédié à la logique. Identifier lequel des deux hémisphères est prédominant permettrait d’adapter les méthodes d’apprentissage en conséquence. Cette croyance découle d’une mauvaise interprétation des résultats d’études en neurosciences.
Pourquoi est-ce une fausse croyance ? Des chercheurs de l’Université de l’Utah ont analysé le fonctionnement cérébral de mille individus par IRM. Ils ont constaté qu’aucun hémisphère ne domine l’autre. Les deux hémisphères sont constamment connectés et travaillent de concert. Un individu n’est jamais totalement analytique ou totalement créatif.
Neuromythe n°4 : On apprend mieux dans son style d’apprentissage
Selon ce neuromythe, nous avons tous des préférences d’apprentissage (certains sont plus visuels, d’autres plus auditifs, ou encore kinesthésiques). En conséquence, il serait plus efficace d’enseigner en utilisant le canal préféré de l’apprenant pour améliorer son apprentissage.
Pourquoi est-ce une fausse croyance ? Il est vrai que nous pouvons avoir des préférences d’apprentissage. Cependant, l’idée que nos préférences renforcent automatiquement la qualité de notre apprentissage est remise en question. Aucune étude n’a prouvé de lien entre la modalité sensorielle utilisée et l’efficacité de la méthode d’apprentissage.
De plus, la majorité des études menées ces dernières années montrent que c’est la combinaison de PLUSIEURS canaux sensoriels qui renforce notre apprentissage.
En somme, il faut tenir compte de la sensibilité des apprenants et combiner différentes méthodes d’enseignement.
Neuromythe n°5 : La « gym cérébrale »
La « Gym Cérébrale » consiste en des exercices de coordination visant à optimiser le développement cérébral. Selon cette idée, des mécanismes neurologiques tels que la lecture pourraient être influencés par des exercices physiques spécifiques, comme les mouvements croisés. Ces exercices de coordination entre les côtés du corps permettraient de rétablir les connexions entre les neurones, optimisant ainsi le développement cérébral, la concentration, la mémoire et l’apprentissage.
Pourquoi est-ce une fausse croyance ? Selon Steeve Masson, il n’existe pas de preuves empiriques solides démontrant les effets de ces mouvements sur la reconnexion des deux hémisphères. Les principes à la base de la « Gym Cérébrale » ont été réfutés par la science. Néanmoins, la « Gym Cérébrale » reste une forme d’exercice physique, recommandée pour la santé. Les neurosciences confirment que l’exercice physique contribue à activer les régions cérébrales liées à l’attention et à la concentration.
Neuromythe n°6 : Écouter Mozart rend plus intelligent
Cette idée découle d’une étude menée en 1993 par Gordon Shaw, physicien, et Francis Rauscher, ancien violoncelliste de concert et spécialiste du développement cognitif. Ils ont avancé l’hypothèse de l’effet Mozart, qui affirme que des étudiants ayant écouté la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart (K 448) ont montré une amélioration nette dans un test de raisonnement spatial. Shaw et Rauscher ont créé leur propre institut, le Music Intelligence Neural Development Institute (ou M.I.N.D.).
De plus, une vive excitation a été suscitée par les médias autour du musicien et entrepreneur Don Campbell, qui a publié en 1997 le best-seller « L’effet Mozart : Exploiter le pouvoir de la musique pour soigner le corps, renforcer l’esprit et libérer la créativité ». Selon Campbell, la musique de Mozart aurait des pouvoirs miraculeux pour le cerveau. Cette idée s’est répandue rapidement, avec des rats, des plantes et même des femmes enceintes écoutant du Mozart. Le gouverneur de Géorgie a même envoyé des CD de musique classique aux parents de nouveau-nés de l’État.
Pourquoi est-ce une fausse croyance ? Les méta-analyses sur l’effet Mozart ont donné des résultats contradictoires. Jakob Pietshnig de l’Université de Vienne (Autriche) et ses collègues ont réalisé une étude approfondie impliquant près de 40 études, 104 échantillons indépendants et plus de 3 000 participants. Ils ont conclu que :
- Les participants ayant écouté la sonate de Mozart KV 448 ont montré des résultats spatiaux significativement meilleurs que ceux exposés à des stimuli non musicaux ou à l’absence de stimulus.
- Les participants ayant écouté un autre type de musique ont obtenu des résultats spatiaux significativement meilleurs que ceux exposés à des stimuli non musicaux ou à l’absence de stimulus.
- Les études menées par les chercheurs affiliés au laboratoire de Frances Rauscher (à l’origine de « l’effet Mozart ») étaient trois fois plus grandes que celles menées par d’autres laboratoires.
Jakob Pietshnig et ses collègues ont conclu :
« En résumé, il reste peu de preuves pour soutenir l’idée d’une amélioration spécifique de la performance spatiale par l’exposition à la sonate KV 448 de Mozart. »
Autrement dit, l’effet Mozart n’a pas un impact miraculeux sur l’intelligence.
Comment éradiquer ces neuromythes ?
Nous avons interviewé M. Philippe Lacroix, co-fondateur de ILDI – Conseil digital learning, edtech, stratégie de formation, et co-auteur du livre « Neurolearning », écrit avec le Dr Nadia Medjad et Philippe Gil. Nous avons discuté de la neuropédagogie : comment les neurosciences éclairent la pédagogie à l’ère numérique pour développer des formations professionnelles plus performantes et motivantes. M. Lacroix explique que la première étape pour combattre les neuromythes est d’en discuter. Les formateurs et les enseignants doivent être formés à l’impact de ces croyances erronées qui peuvent nuire à l’apprentissage.
Ainsi, avant d’adopter des stratégies ou de développer des outils basés sur la recherche cérébrale, les enseignants et les formateurs doivent examiner attentivement et critiquement les recherches et leur applicabilité réelle en classe ou dans une formation.